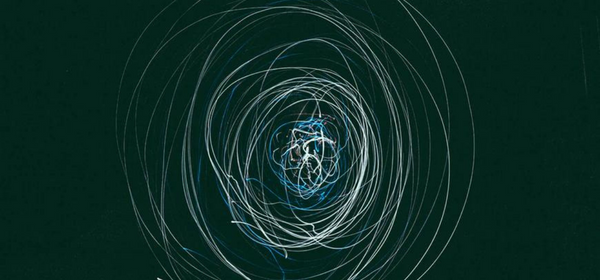Puisqu’on se dit tout, on peut se le dire entre nous : il y a des expressions toutes faites qui sont tellement présentes dans les discours qu’on finit par les trouver insignifiantes, voire agaçantes. La notion d’« Intelligence collective » est aujourd’hui gravement menacée par ce fléau du mot qui fait un tel tube qu’il finit par sonner creux. Voilà qui est bien ennuyeux car de l’intelligence collective, de la vraie, qui se traduit par des actions, on en a bien besoin en entreprises. Il est urgent de réinvestir de sens le concept d’intelligence collective.
Si déjà, on savait définir l’intelligence…
Le premier problème avec l’intelligence collective, c’est de définir l’intelligence tout court. La question taraude philosophes et scientifiques depuis l’Antiquité, parents et psys depuis plusieurs décennies. A minima, on s’accorde à dire que l’intelligence, c’est la capacité à apprendre et à s’adapter. Mais ça fait un peu court parce qu’en ce cas, quiconque est apte à capter les signaux de son environnement et à y réagir en retenant un brin de leçon de son expérience pour les fois suivantes pourrait être considéré comme une graine de génie.
D’aucun·e·s apportent donc volontiers à la définition de l’intelligence une dimension d’appréhension de la complexité : l’intelligence commencerait où, face à une diversité d’informations, éventuellement désordonnées, portant possiblement des messages contraires, on saurait mettre en œuvre des compétences cognitives. Vu comme ça, l’intelligence se rapproche du process. Mais il n’est pas sûr que l’on trouve toujours nos process si futés que ça ni celles et ceux qui les suivent docilement à la lettre si rusé·e·s.
Alors, on remonte d’un étage et on trouve une définition de l’intelligence intégrant la capacité à résoudre des dilemmes. Sauf que chez certain·e·s, le problème moral est soluble dans les croyances, qui sans exclure l’intelligence, n’en sont pas nécessairement la manifestation la plus probante.
Alors, l’intelligence serait à chercher du côté de l’aptitude à conceptualiser ? sauf qu’on a rencontré plus d’un·e intellectuel·le qui, comment dire, manquait d’intelligence… euh, d’intelligence émotionnelle ? C’est qu’être intelligent·e, ce serait aussi avoir le sens des situations, un brin d’empathie, quelques soft-skills pas inutiles pour évoluer avec agilité dans un monde diversifié et en continuelle transformation.
Etre « en (bonne) intelligence » : un art relationnel
La plupart des approches contemporaines de l’intelligence humaine abordent la question par l’angle des qualités individuelles. Mais c’est oublier qu’historiquement, l’intelligence signifie la connivence. Sont « en intelligence » celles et ceux qui s’entendent secrètement. Vivent « en bonne intelligence » celles et ceux qui savent préserver la qualité des relations, pacifiquement, en faisant œuvre de diplomatie et en recherchant le compromis.
Dans cette perspective, l’intelligence n’est pas tant l’expression des capacités de chacun·e que la manifestation d’un équilibre commun. En d’autres termes, notre intelligence individuelle relève avant tout de notre sens des responsabilités quant à ce qui est partagé. Il y va d’écologie relationnelle : conscience de soi et de ses impacts sur l’environnement, préservation des ressources des autres et du commun, contribution à la création de valeur au sein d’une chaîne d’interdépendances.
L’intelligence collaborative, un grégarisme sophistiqué
Ce sont les entomologistes qui, les premiers, s’intéressent à l’intelligence collective en observant l’organisation des interdépendances chez certains insectes. Edward O. Wilson consacre ainsi une partie de sa vie à étudier la façon dont les fourmis communiquent entre elles et établissent des règles comportementales que toute la colonie sait faire évoluer en fonction des caractéristiques du milieu. Fascinant ! Fascinant de voir ces créatures au cerveau plus petit qu’une tête d’épingle s’organiser, c’est une chose, mais surtout s’adapter. Fascinant de les voir résorber un embouteillage si efficacement et rapidement que c’est à faire pâlir de jalousie tou·te·s les ingénieur·e·s en quête de solutions pour le périph’ aux heures de pointe. Fascinant d’observer comme les récolteuses rapportent à la colonie des denrées qui vont composer un menu contenant tous les nutriments nécessaires au juste équilibre des besoins des membres de la colonie, comme si elles avaient checké dans le garde-manger de la collectivité ce qu’il y avait et ce qui manquait avant de partir faire les commissions.
Fort de ces observations, Wilson fonde une nouvelle discipline des sciences humaines : la sociobiologie. Il entend proposer une lecture des théories évolutionnistes de Darwin appliquées aux comportements individuels et collectifs. Rompant avec le distinguo innée-acquis, cette approche par « l’écologie comportementale » met en évidence une naturelle propension de certaines espèces grégaires (dont l’humain) à œuvrer collectivement au maintien d’une biodiversité nécessaire à la survie de l’espèce mais aussi à l’élaboration de solutions intelligentes pour agir plus vite ou plus efficacement, à la mise en œuvre de projets dépassant l’utilité immédiate, à des formes d’expressions gratuites (au hasard, l’art…).
Folie ou sagesse des foules ?
Oui, alors, dans le monde des fourmis ou celui des bisounours, d’accord ; chez les humains, de temps en temps peut-être. Mais le plus souvent, le collectif nous donne plutôt à voir le tableau inquiétant de dérives : paresse sociale qui fait qu’en groupe, chacun·e se met à imaginer que les autres vont bosser à sa place ; dilution des responsabilités qui fait que dans un collectif, plus personne ne se sent directement concerné par rien ; effets d’entraînement qui voient de gentils bonshommes pris isolément se transformer en affreux garnements quand ils agissent en bande… Il y a bien de quoi avoir peur des foules !
Dans son ouvrage paru en 1895, Psychologie des foules, l’anthropologue Gustave Le Bon les qualifie carrément de « folles ». Il met en évidence une « unité mentale » du groupe, indépendante des mentalités des individus qui le composent. Une des caractéristiques fortes de cette « unité mentale », c’est l’extrême sensibilité aux croyances, aux circonstances, aux aléas. Autrement dit, la foule selon Le Bon, c’est le terreau favori des biais, des réactions immédiates, des décisions irraisonnées. Avec cela, les collectifs sont des organismes sympathiques (au sens biologique du terme) très propices aux contagions : les idées (potentiellement fausses) et les rumeurs, les suggestions et les mouvements s’y propagent à grande vitesse. Les foules sont très difficilement contrôlables, nous dit le scientifique.
Un peu plus d’un siècle après, l’essayiste américain James Surowiecki répond à Le Bon dans un ouvrage intitulé La sagesse des foules. Puisque le collectif est une « entité mentale » en soi d’une part et qu’il est très réceptif à son environnement d’autre part, rien n’indique a priori qu’il est forcément bête, déraisonnable et excessif. L’auteur va plus loin en faisant démonstration qu’un groupe d’amateurs est au moins autant capable (si ce n’est davantage) de trouver une solution pertinente à un problème qu’un seul expert. Et de faire référence à diverses expériences de problèmes simples ou complexes auxquels un groupe d’individus ayant un vécu en partage ou bien confrontant des points de vue aboutissent à des réponses efficaces ou innovantes. Par exemple, si on demande à 1000 personnes d’estimer le poids d’un objet ordinaire que toutes ont l’habitude d’utiliser (une casserole, un bouquin…), aucune ne donnera la masse exacte mais la moyenne s’approchera à quelques grammes près du poids mesuré par une balance. Autre exemple, les groupes d’autosupports rassemblant des personnes atteintes de maladies : en partageant leur expérience des traitements, leurs pratiques pour gérer les effets secondaires, leurs solutions pour soulager la douleur, leurs expériences pour gagner en qualité de vie, les patient·e·s co-élaborent des protocoles de soin montrant des taux d’amélioration de l’état de santé majoritairement plus élevés que chez les patient·e·s qui ne sont suivi·e·s que par des médecins. Et ce n’est pas que l’effet psychique du soutien apporté par le groupe qui joue : les soignant·e·s recueillent l’information d’usage issue de ces groupes pour l’intégrer à leurs pratiques… Car cette information est pertinente !
Donner au collectif les moyens de son intelligence
Le collectif est parfaitement capable d’intelligence, c’est prouvé. Reste à savoir comment d’une part, l’empêcher de faire preuve de déraison et d’autre part de le mettre en conditions de produire une valeur que chaque individu ne pourrait créer de son côté.
Pour la première question, celle de la prévention des risques de dérives de l’effet de groupe, c’est du côté du management de l’inclusion que l’on trouve pas mal d’éléments de réponses. Les déviances d’un groupe procèdent principalement des frustrations liées à l’effet Janis. L’effet Janis, c’est la tendance d’un collectif à se diriger vers le pseudo-consensus pour résoudre ses problèmes. En réalité, le collectif qui verse dans la tentation de s’en remettre à l’opinion majoritaire, à l’autorité ou aux positions les plus centrales, ne règle aucun problème : il ne fait qu’éviter les conflits. Concrètement : on a 10% d’extrêmes d’un côté, radicalement opposés à 10% d’extrême de l’autre ; ensuite, on a 10% à 30% de positions conservatrices (au sens de désireuses de maintenir le plus possible la situation en l’état) et autour un ventre mou d’indécis·e penchant plus ou moins d’un côté ou de l’autre des postures les plus radicales. L’effet Janis va s’opérer quand, après avoir disqualifié les points de vue identifiés comme les plus extrêmes, le centre va agglomérer la majorité flottante. Dans un collectif de travail confronté à une problématique de changement : on écarte ceux qui veulent tout changer en se projetant dans l’avenir (les révolutionnaires), ceux qui veulent un retour à une situation antérieure (les réactionnaires), après quoi le noyau central silencieusement et passivement rétif au changement ramène à lui ceux qui aspirent à la transformation mais acceptent de temporiser, ceux qui sont en conflit intérieur entre envie et changer et confort de l’inertie, ceux qui ont conscience du besoin de changement tout en ayant peur etc. A l’arrivée, on ne change rien ou presque rien… Et on frustre terriblement les positions les plus radicales qui vont avoir tendance à se braquer et à réagir avec force, entraînant dans leur mouvement de protestation les faussement ralliés au consensus. Pour lever cet effet Janis, il va donc falloir d’abord s’interdire de disqualifier les opinions divergentes : on peut ne pas y adhérer, mais il va être essentiel de les laisser s’exprimer et de les écouter. Puis il va falloir dynamiser la majorité volatile de façon à ce qu’elle agisse en assembleur créatif des diverses idées proposées.
Pour que le groupe se fasse agent créatif, producteur de solutions nouvelles, il faut qu’un certain nombre de conditions soient réunies :
- La confiance, celle que les individus ont en eux mais surtout celle qui traverse leur relation. Concrètement, cela implique la possibilité d’être en désaccord sans que cela entame l’estime réciproque.
- La gestion des rapports d’autorité : un collectif est encore plus biaisé qu’un individu par l’autorité statutaire ou perçue de ceux qui prennent la parole en son sein. Par exemple, « l’expert » bénéficiera d’une meilleure écoute a priori que le quidam ; ce qui n’est pas choquant en soi, sauf si cela induit qu’aucune explication ne sera demandée à l’expert sur ce qu’il affirme, au risque de le laisser affirmer des choses imprécises, incomplètes ou bien influencées par ses propres biais cognitifs. Il est donc indispensable de surveiller comme le lait sur le feu tous les phénomènes d’autocensure susceptibles de s’installer dans un groupe dès lors que des individus y entrent avec une légitimité spécifique.
- La participation : un collectif dynamique doit désarmer les postures personnelles pour laisser pleine place à la posture participative de chacun. Il y va notamment d’éviter que le groupe se constitue en public des plus fortes personnalités qui y viendraient faire le show. Il y va aussi d’autoriser les contributions inattendues (par exemple, la prise de parole sur un sujet d’une personne qui n’est absolument pas repérée comme connaisseuse de celui-ci ou bien l’expression des émotions chez un individu que son statut et ses fonctions amènent d’ordinaire à prendre plutôt des positions basées sur la raison…). Pour cela, il sera essentiel de considérer qu’une prise de parole en collectif n’est pas seulement le point de vue d’un individu (et qu’on pourrait lui en tenir rigueur en d’autres circonstances) mais qu’elle est d’abord un acte de participation qui reflète la dynamique des échanges.
- La plasticité : pour entretenir son intelligence, un collectif a besoin de souplesse et de modularité. Il doit pouvoir intégrer de nouveaux éléments en s’adaptant continuellement à la fois à l’expression de nouveaux points de vue et aux mutations du contexte environnant.
Marie Donzel, pour le webmagazine EVE.