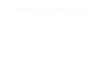Quand vous avez lu le titre de cet article à voix haute, vous avez pu être pris·e d’une légère inquiétude : quoi, on va donner tout pouvoir aux ados ?! Pas de panique, l’adhocratie est une modalité d’organisation du travail particulièrement adaptée aux contextes instables et complexes. Ses deux principaux atouts : la pluridisciplinarité et la souplesse. On vous explique tout.
C’est quoi le phénomène Baader-Meinhof ?
L’essentiel à savoir sur « l’illusion de fréquence ».
C’est étrange, depuis que vous avez appris que votre collègue …
La sororité, c’est la fraternité pour les femmes ? On en parle !
Depuis 2021, l’ONU consacre une Journée mondiale de la fraternité humaine, célébrée le 4 février. Dédiée à la promotion du dialogue interreligieux et interculturel, elle renvoie dans son intitulé à un grand principe des Lumières : la considération de tous les hommes par tous les hommes comme s’ils étaient frères. Et les sœurs, alors ?
Le rire est le propre de l’homme… Et de la femme ? On en parle !
Quand François Rabelais dit « le rire est le propre de l’homme », on comprend bien entendu qu’il parle de l’humanité… Mais la question mérite quand même d’être posée : est-ce que femmes et hommes sont égaux face au rire ? Pour en avoir le cœur net, jetons un œil aux chiffres et à la littérature scientifique sur le sujet.
Pourquoi les poches des vêtements féminins sont-elles plus petites ? On en parle !
Le sexisme se cache dans les détails… Jusqu’à se loger dans la taille des poches des vêtements. Non, mais sérieusement ? Un article sur les écarts de traitement face au prêt-à-porter ? Eh oui, car derrière cette question des poches, il y a toute une histoire qui parle de liberté, d’indépendance et même d’objectivation du corps des femmes. On en parle !
Les toilettes, une question de genre ? On en parle !
En 2012, la 67è Assemblée générale de l’ONU décide de consacrer une Journée mondiale des toilettes, qui se tiendra tous les ans le 19 novembre. « Les toilettes sont petites mais puissantes » lit-on sur la page du site de l’organisation internationale qui fait résonner cet événement annuel avec l’Objectif de Développement Durable n°6 : Garantir l’accès à tous des services d’alimentation en eau et d’assainissement gérés de façon durable d’ici à 2030.
Il en va bien entendu de droit à l’hygiène et subséquemment, de prévention de nombreux risques de santé. Mais l’ONU évoque tout particulièrement l’enjeu de la condition des filles et des femmes au cœur de cette Journée mondiale. Mais pourquoi donc ?
Les investisseurs sont-ils piqués par le virus de la parité ? On en parle !
L’écosystème du financement des entreprises a connu une (pas si) petite révolution en 2022 : cette année-là, les fonds ont davantage investi en série A dans les start-ups ayant des équipes mixtes à leur tête que dans des start-ups dirigées par des équipes exclusivement masculines !
Le sexisme dans la pub, on en parle ?
Peut-être suivez-vous le compte « Pépite sexiste » sur Twitter et/ou Instagram. En ce cas, vous aurez vu passer des campagnes de Saint-Valentin d’un goût discutable, une réclame pour des sachets de thé jouant sur les rôles genrés dans la parentalité, la bannière d’un site e-commerce assumant le stéréotype de la femme dépensière, une palanquée de visuels de jouets genrés et du biais en veux-tu-en-voilà dans les messages publicitaires. La publicité aurait-elle du mal à faire sa révolution anti-sexiste ? On en parle !
Un concept à la loupe : la charge écologique
Forgé par la sociologue Monique Haicault en 1984 et massivement popularisée par l’illustratrice Emma en 2017, le concept de « charge mentale » a désormais ses notions dérivées : on parle de « charge contraceptive » pour évoquer le fait que la prévention des grossesses non désirées repose principalement sur les femmes ou de « charge émotionnelle » pour dire la surexposition des femmes aux demandes affectives de leurs entourages (familial, professionnel, de voisinage etc.). Au chapitre des « charges cognitives », on parle aussi de plus en plus de « charge écologique ».
Mais de quoi s’agit-il exactement ? La rédaction du webmagazine EVE passe le concept à la loupe.
Au cinéma (et ailleurs), le « male gaze », on en parle ?
En 1981, sortait le film « Sois belle et tais-toi » de Delphine Seyrig. 35 ans avant #MeToo, l’actrice et réalisatrice donnait la parole à une vingtaine de femmes de cinéma, depuis Maria Schneider jusqu’à Jane Fonda, en passant par Shirley McLaine, Patti d’Arbanville ou Anne Wiazemsky. Sans nommer le concept, ces femmes parlaient déjà du « male gaze » et de ses effets sur la condition des actrices sur les tournages et dans l’industrie du 7è art mais aussi sur l’image de la femme dans toute la société. Au cinéma, les hommes portent le regard et les femmes sont regardées, en somme. Et cela façonnerait nos imaginaires dans une répartition des rôles genrés.
Mais pourquoi ce « male gaze » suscite parfois la polémique ? On en parle !